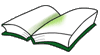Accueil
Accueil
| Titre : | Les discordances du moi : Essai sur l'identitÃĐ personnelle au regard de la transplantation d'organes |
| Auteurs : | Simone Romagnoli, Auteur |
| Type de document : | texte imprimÃĐ |
| Editeur : | Nancy [France] : Presses universitaires de Nancy, 2010 |
| Collection : | EpistÃĐmologie du corps |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8143-0023-1 |
| Format : | 356 p. / Bibliographie |
| Langues: | Français |
| Index. dÃĐcimale : | ER/A (BioÃĐthique: ouvrages gÃĐnÃĐraux abordant diverses questions) |
| RÃĐsumÃĐ : |
La rÃĐflexion sur lâidentitÃĐ personnelle traverse la tradition philosophique occidentale depuis lâAntiquitÃĐ. Pourtant, la question de savoir ce qui constitue lâidentitÃĐ de la personne à travers le temps est encore sujette à controverse : est-ce la continuitÃĐ de lâÃĒme, du corps, de la mÃĐmoire, du cerveau fonctionnel ou des fonctions vitales constitutives de lâespÃĻce ? En analysant les principales conceptions philosophiques qui sâaffrontent depuis Locke, Simone Romagnoli tente de rÃĐsoudre l'opposition qui est venue à se constituer entre la question mÃĐtaphysique ÂŦ Que suis-je ? Âŧ et la question ÃĐpistÃĐmologique ÂŦ Qui suis-je ? Âŧ.
La problÃĐmatique de lâidentitÃĐ personnelle à travers le temps est abordÃĐe sous lâangle particulier de la transplantation dâorganes. GrÃĒce à lâÃĐtude de lâargument dit du ÂŦ changement de corps Âŧ, qui se base sur lâhypothÃĻse de la greffe de cerveau, lâAuteur dÃĐgage les prÃĐsupposÃĐs conceptuels qui conditionnent la perception des enjeux soulevÃĐs par les cas rÃĐels de transplantation. Il est ainsi possible de comprendre pourquoi les thÃĐoriciens de lâidentitÃĐ qui sây intÃĐressent semblent incapables de penser avec justesse les dÃĐfis que leur lance lâune des plus grandes avancÃĐes thÃĐrapeutiques du XXe siÃĻcle. Face aux patients qui demandent ÂŦ Qui suis-je maintenant ? Âŧ, les outils conceptuels à disposition des thÃĐoriciens semblent les conduire dans une impasse. En mobilisant dâautres savoirs comme la physique et la mÃĐdecine (physiologie et psychiatrie notamment), Simone Romagnoli dÃĐveloppe un modÃĻle thÃĐorique concurrent à celui dâidentitÃĐ personnelle : lâunitÃĐ personnelle transductive. Ce modÃĻle, qui se base sur une philosophie du corps et de lâexpÃĐrience vÃĐcue, invite à penser autrement ces cas individuels (de lâintersexualitÃĐ aux personnes en situation de handicap en passant par la transplantation dâorganes) qui dÃĐjouent les catÃĐgories philosophiques hÃĐritÃĐes, à partir desquelles se construit notre conception de la personne. |
| Note de contenu : |
- PrÃĐface (Bernard Baertschi)
- Introduction - Position de la problÃĐmatique - Le dÃĐroulement dâun travail au croisement de diffÃĐrentes disciplines - Plan du travail - Remerciements PREMIÃRE PARTIE - 1. Les chantiers philosophiques contemporains de lâidentitÃĐ personnelle : §1 Les Conceptions rÃĐductionnistes (complexes) et non-rÃĐductionnistes (simples) de lâidentitÃĐ personnelle : un aperçu / §2 Au cÅur de la problÃĐmatique : la persistance et lâÃĐvidence relÃĻvent-elles de niveaux inconciliables ? / §3 ÂŦ IdentitÃĐ(s) Âŧ / §4 ÂŦ Personne Âŧ et/ou ÂŦ Être humain Âŧ - 2. Esquisse dâune conception de lâunitÃĐ personnelle transductive : §5 Discordance et transductivitÃĐ de la personne : Gilbert Simondon. Discordance et passivitÃĐ du moi / §6 Une conception unifiÃĐe de la personne : lâimage du corps / §7 Le positionnement de la conception de lâunitÃĐ personnelle transductive dans les chantiers contemporains. Quatre hypothÃĻses de travail DEUXIÃME PARTIE - 1. Les thÃĐories prÃĐmodernes et contemporaines de lâidentitÃĐ personnelle et la rÃĐvocation de la condition corporelle : §8 AntÃĐcÃĐdents : lâamputation et lâÃĐchange des corps (8.1 Descartes ; 8.2 Locke) / §9 Le critÃĻre de continuitÃĐ de mÃĐmoire : opposants et partisans )9.1 Butler ; 9.2 Reid ; 9.3 Quinton, Parfit et le critÃĻre de continuitÃĐ de mÃĐmoire rÃĐvisÃĐ ; 9.4 Williams) - 2. Le thÃĻme de la transplantation cÃĐrÃĐbrale dans le dÃĐbat philosophique contemporain : §10 La conception neo-lockÃĐenne de Sydney Shoemaker et lâargument de lâÂŦ extraction cÃĐrÃĐbrale Âŧ / § 11 approche somatique I (le critÃĻre cÃĐrÃĐbral) : Wiggins et le cerveau comme condition nÃĐcessaire et suffisante de lâidentitÃĐ personnelle / §12 Approche somatique II (Le critÃĻre corporel) : Williams propose un argument mÃĐthodologique qui contredit lâÂŦ intuition de transplantation Âŧ / §13 Approche psychologique I : Nagel et le cerveau comme condition nÃĐcessaire de lâidentitÃĐ personnelle / §14 Approche psychologique II : Parfit propose une rÃĐvision de la continuitÃĐ psychologique et lâabandon de lâidentitÃĐ personnelle / §15 Approches somatique III (Le critÃĻre biologique ou animaliste) : Un argument contre lâÂŦ intuition de transplantation Âŧ / §16 Discussion critique sur le caractÃĻre subjectif de lâexpÃĐrience et sur la mÃĐmoire dÃĐsincarnÃĐe TROISIÃME PARTIE - 1. UnitÃĐ personnelle transductive et image du corps : §17 Reprise et caractÃĐrisation de la problÃĐmatique / §18 LâanthropogenÃĻse : Maine de Biran : la thÃĐorie du corps propre et la doctrine des points de vue / §19 Le cas de Jean-Luc Nancy / §20 Le cas dâOliver Sacks : une tentative dâinterprÃĐtation / §21 LâImage du corps : Quelques prÃĐcisions sur les notions de ÂŦ schÃĐma corporel Âŧ et dâÂŦ image du corps Âŧ ; L'origine neuropathologique du schÃĐma corporel ; La deuxiÃĻme filiation : la psychanalyse (moi corporel et image du corps) / §22 Lâimage du corps chez Paul Schilder / §23 Image du corps et unitÃĐ personnelle transductive - 2. Image du corps et transplantation dâorganes : §24 Troubles identitaires et transplantation dâorganes : remarques introductives / §25 Petite phÃĐnomÃĐnologie de la greffe cardiaque sur fond du parallÃĻle entre le phÃĐnomÃĻne du fantÃīme et les troubles identitaires chez les patients transplantÃĐs - Conclusion - Bibliographie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | DisponibilitÃĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| ER/A 013 | ER/A 013 | Livre | Bibliothèque principale | Livres empruntables | PrÊt possible Disponible |