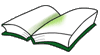Accueil
Accueil
| Titre : | La Carthage de saint Augustin |
| Auteurs : | Gilbert Charles-Picard, Auteur |
| Type de document : | texte imprimÃĐ |
| Editeur : | Paris [France] : Librairie ArthÃĻme Fayard, 1965 |
| Collection : | RÃĐsurrection du passÃĐ |
| Format : | 222 p. / Bibliographie; photos N&B |
| Langues: | Français |
| Index. dÃĐcimale : | GJ/D (Histoire de l'Eglise : 313-5e s (conciles ÅcumÃĐniques)) |
| RÃĐsumÃĐ : |
A la Carthage punique, que les lÃĐgions effacÃĻrent du sol et que Flaubert devait faire revivre en des pages cÃĐlÃĻbres, succÃĐda une Carthage romaine, qui fut une brillante et luxueuse citÃĐ. VÃĐritable capitale oÃđ convergeaient les intelligences de l'Afrique, saint Augustin y poursuivit ses ÃĐtudes, mais aussi d'autres expÃĐriences qui allaient, pour une bonne part, dÃĐcider de son ÃĐvolution spirituelle.
Pendant quatre siÃĻcles, cette Carthage romaine connut une vie active, tumultueuse, passionnÃĐe, faisant dire à saint Augustin qu'il "y crÃĐpitait, comme une huile bouillante, lâeffervescence des amours honteusesâ. A la veille mÊme de sa chute, dans ce IVe siÃĻcle oÃđ elle brilla dâun suprÊme ÃĐclat, s'y coudoyaient trafiquants, artisans, courtisanes, grands seigneurs et manants, thÃĐologiens et rhÃĐteurs. Câest ce monde bigarrÃĐ, et si sÃĐduisant aussi par tant de ses aspects, que Gilbert Charles-Picard reconstitue en une vaste fresque. Profond connaisseur de Carthage et de lâAfrique du Nord, oÃđ il a fait de nombreuses fouilles, l'auteur a eu recours à une abondante documentation. Celle-ci emprunte aux textes qui nous sont parvenus mais aussi, trÃĻs largement, aux tÃĐmoignages de l'archÃĐologie, dont beaucoup sont encore inÃĐdits ou peu connus, notamment les mosaÃŊques exhumÃĐes, dont l'imagerie constitue des rÃĐcits riches de dÃĐtails et d'ÃĐvocations. Faisant ainsi tout à la fois Åuvre d'historien et d'archÃĐologue, Gilbert Charles-Picard fait revivre intensÃĐment cette Carthage grouillante d'hommes et d'idÃĐes dans ce volume oÃđ le texte est constamment IllustrÃĐ de trÃĻs belles reproductions photographiques. |
| Note de contenu : |
- Avant-propos
- 1. LA ÂŦ POÃLE DES AMOURS COUPABLES Âŧ : La Carthage cÃĐsarienne et la Carthage augustÃĐenne. â Ãtendue et population de la ville. â La reconstruction du IVe siÃĻcle. â Les quartiers du sud : les ports et lâamphithÃĐÃĒtre. â Monuments et maisons sur les collines du centre. â Le quartier des thermes dâAntonin : un vaste musÃĐe de plein air. â VitalitÃĐ et grands travaux au ive siÃĻcle. â Transformations urbaines et traditionalisme. - 2. HEURS ET MALHEURS D'UN GRAND PORT : Le ÂŦ tophet Âŧ et ses sacrifices dâenfants. â Saturne se substitue à Baâal Hammon. â Les ports et les docks romains. â Le ravitaillement de Rome à la merci de Carthage. â Une rÃĐvolution sÃĐvÃĻrement rÃĐprimÃĐe. â Les catastrophiques consÃĐquences dâune usurpation. â Qui a dÃĐtruit les ports de Carthage? â Domitius Alexander, jouet des nationalistes africains. â La politique dâapaisement de Constantin. â Un fastueux palais. â Le symbolisme des saisons. â Abondance et fÃĐlicitÃĐ de la terre dâAfrique. â Renouveau du loyalisme romain de Carthage. 3. CHASSES ET SPORTS, RELIGION ET MAGIE : Une dÃĐcouverte inattendue et sensationnelle. â Une imagerie des chasses. â Le thÃĻme de la chasse dans lâart romain. â ExpÃĐditions romaines en Afrique tropicale. â Deux notables reprÃĐsentÃĐs en pÊcheurs. â La salle à manger des Saisons. â Style et signification symbolique dâune mosaÃŊque. â Un sorcier nÃĻgre. â Les enfants chasseurs : un sport cruel mais aristocratique. â Un album mythologique : la mosaÃŊque des chevaux. â Lâimportance des courses dans la civilisation romaine. â Le rÃīle social et politique des ÃĐcuries de courses. â Un proconsul dÃĐtourne saint Augustin des astrologues. â Astrologie et superstitions relatives aux courses. â Un chef-dâÅuvre exceptionnel. â Le siÃĻge de la ÂŦ faction bleue Âŧ. â LâÃĐnigme du pavement des chevaux. â Un futur ÃĐvÊque fanatique du cirque. - 4. LES DERNIERS PAÃENS : Un peuple de dieux dans un mystÃĐrieux caveau. â PaÃŊens et chrÃĐtiens au IVe siÃĻcle. â Les aventures dâun petit convent paÃŊen. â Des dieux de toutes les paroisses dans un ÂŦ bunker Âŧ. â Les thÃĐurges du IVe siÃĻcle. â Le triomphe de VÃĐnus et les spectacles nautiques. â DÃĐfense et illustration du paganisme. â Superstitions communes aux paÃŊens et aux chrÃĐtiens. âLâÃĐtrange histoire de sainte Salsa à Tipasa. âLa coupure entre le christianisme et le paganisme. â Quelques tÃĐmoignages de la rÃĐsistance paÃŊenne._ La formation dâun christianisme populaire. - 5. LA SOCIÃTà DE CARTHAGE : SEIGNEURS ET MANANTS : Une aristocratie hiÃĐrarchisÃĐe, essentiellement terrienne. â Un moyen seigneur : Romanianus. â Les grands domaines ruraux. â La mainmise des grands propriÃĐtaires sur le commerce, lâindustrie et les professions libÃĐrales. â Les obstacles à la puissance des grands : lâÃtat, lâÃglise et lâarmÃĐe. â Les rÃĐsistances paysannes et le rÃīle des ÂŦ circoncellions Âŧ. â Villas champÊtres et domaines de plaisance. â Le livre dâimages de la vie noble. â La dame en son jardin, le seigneur en son verger. â Luxe des grands et misÃĻre des pauvres. â Beuveries et banquets. â Carthage nâa pas ÃĐtÃĐ une seconde Sodome. â La mÃĐsaventure de lâÃĐtudiant Alypius. â Ãtudiants chahuteurs et ÂŦ enfants docteurs Âŧ. - 6. LA VIE POLITIQUE : CULTE IMPÃRIAL ET CHRISTIANISME : Un beau portrait de Constance II â Un personnage shakespearien. â Une dÃĐdicace liÃĐe au drame qui a suivi la mort de Constantin. â Le siÃĻge dâune association vouÃĐe au culte impÃĐrial. â Le christianisme face à la vÃĐnÃĐration impÃĐriale. â Le thÃĻme des trois jeunes HÃĐbreux jetÃĐs dans la fournaise. â La ÂŦ Dame de Carthage Âŧ, symbole du pouvoir impÃĐrial. â Une manifestation de lâopposition carthaginoise au sÃĐparatisme? - 7. LE CHRISTIANISME CARTHAGINOIS : Une tentative de recensement des ÃĐglises. â Un prÃĐtendu temple dâEsculape qui Se rÃĐvÃĻle un ÃĐdifice chrÃĐtien. â Sâagit-il de la ÂŦ memoria Âŧ de saint Cyprien? â Les pauvres vestiges de la cathÃĐdrales antique. â De prÃĐcieux bas-reliefs : lâadoration des bergers et des mages. â Les reliques des martyrs mis à mort dans lâamphithÃĐÃĒtre. â Images du peuple chrÃĐtien sur des mosaÃŊques tombales. â Sur un verre gravÃĐ, les apÃītres Pierre et Paul reprÃĐsentÃĐs en pÊcheurs. â Le IVe siÃĻcle, temps du secret et de lâinitiation. â Les lampes, indices de la christianisation et preuves de la prospÃĐritÃĐ. â Lâopposition topographique de la Carthage paÃŊenne et de la Carthage chrÃĐtienne. â Ralliement tardif de lâaristocratie au catholicisme. - Conclusion - Bibliographie - Table des illustrations |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | DisponibilitÃĐ |
|---|---|---|---|---|---|
| GJ/D 020 | GJ/D 020 | Livre | Bibliothèque principale | Livres empruntables | PrÊt possible Disponible |