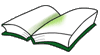Accueil
Accueil
| Titre : | Sociologie de la religion : Economie et sociƩtƩ |
| Auteurs : | Max Weber, Auteur ; Isabelle Kalinowski, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimƩ |
| Editeur : | Paris [France] : Flammarion, 2006 |
| Collection : | Champs, num. 718 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-08-080141-8 |
| Format : | 512 p. / Bibliographie; index |
| Note gƩnƩrale : | Nouvelle traduction |
| Langues: | FranƧais |
| Langues originales: | Allemand |
| Index. dƩcimale : | TB/A (Sociologie des religions; approche chrƩtienne de la sociologie) |
| RĆ©sumĆ© : | AchevĆ©e pour lā€™essentiel en 1913, la Sociologie de la religion est le grand manuel synthĆ©tique qui fait pendant aux Ć©tudes de Max Weber (1864-1920) sur le protestantisme, le judaĆÆsme et les religions de lā€™Asie. Initialement conƧue comme une section de lā€™ensemble posthume Economie et sociĆ©tĆ©, cette Ć©tude fait ici lā€™objet dā€™une Ć©dition sĆ©parĆ©e et dā€™une nouvelle traduction annotĆ©e et commentĆ©e. Max Weber y livre les outils d'une approche Ć la fois systĆ©matique et remarquablement subtile des pratiques religieuses : la Sociologie de la religion nā€™est pas seulement une source dā€™inspiration pour le socio logue, lā€™historien ou lā€™anthropologue, mais aussi une leƧon de tolĆ©rance par lā€™Ć©ducation Ć la finesse du regard. Dans celui de Max Weber, assoupli par un exercice savant, patient et permanent du comparatisme, une alternative comme celle des Ā«primitifsĀ» et des Ā«civilisĆ©sĀ» nā€™a pas lieu dā€™ĆŖtre. En rupture avec lā€™Ć©volutionnisme ethnocentrique de son Ć©poque, Weber insiste moins, sans les nier, sur les diffĆ©rences culturelles et Ā« inter-religieuses Ā» que sur les lignes de conflit internes Ć toutes les religions. Une violente tension sociale oppose selon lui le pĆ´le occupĆ© par les dĆ©tenteurs professionnels du Ā«savoirĀ» religieux, attachĆ©s Ć la dĆ©finition de dogmes et Ć la prĆ©servation de la stabilitĆ© des institutions, au pĆ´le oĆ¹ se retrouvent Ć la fois des Ā«prophĆØtesĀ» et des Ā«virtuosesĀ» religieux en rupture avec les rites et les institutions, ainsi que des laĆÆcs toujours soucieux de rappeler que la religion doit aussi rĆ©pondre Ć des attentes Ā«magiquesĀ» de bienfaits dans la vie quotidienne et de secours face Ć lā€™Ć¢pretĆ© du destin. |
| Note de contenu : |
- Introduction
- Note Ć©ditoriale SOCIOLOGIE DE LA RELIGION - I. GenĆØse des religions : 1.1. Le caractĆØre originellement liĆ© Ć lā€™ici-bas de lā€™action communautaire Ć motivation religieuse ou magique / 1.2. La croyance aux esprits / 1.3. GenĆØse des puissances Ā« suprasensibles Ā» / 1.4. Naturalisme et symbolisme / 1.5. Le monde des dieux et les dieux fonctionnels / 1.6. Culte des ancĆŖtres et prĆŖtres domestiques / 1.7. Les dieux des groupements politiques et les dieux locaux / 1.8. MonothĆ©isme et religiositĆ© du quotidien / 1.9. Universalisme et monothĆ©isme / 1.10. Contrainte du dieu, magie et service du dieu II. Le magicien et le prĆŖtre III. La notion de Dieu. Lā€™Ć©thique religieuse. Le tabou : 3.1. Les divinitĆ©s Ć©thiques. Les divinitĆ©s de la juridiction / 3.2. Signification sociologique des normes de tabou. Le totĆ©misme / 3.3. Tabouisation, constitution de communautĆ©s et stĆ©rĆ©otypisation / 3.4. Ɖthique magique - Ć©thique religieuse : conscience du pĆ©chĆ©, idĆ©e de la dĆ©livrance - IV. Le Ā« prophĆØte Ā» : 4.1. Le Ā« prophĆØte Ā» par opposition au prĆŖtre et au magicien / 4.2. ProphĆØte et lĆ©gislateur / 4.3. ProphĆØte et enseignant / 4.4. Mystagogue et prophĆØte / 4.5. ProphĆ©tie Ć©thique et prophĆ©tie exemplaire / 4.6. CaractĆØre de la rĆ©vĆ©lation prophĆ©tique - V. La communautĆ© : 5.1. Le prophĆØte, sa suite et la communautĆ© / 5.2. La religiositĆ© communautaire / 5.3. ProphĆ©tie et entreprise des prĆŖtres - VI. Le savoir sacrĆ©. La prĆ©dication. La cure des Ć¢mes : 6.1. Savoir sacrĆ©, canon, religion du Livre / 6.2. Dogme et formation dā€™une communautĆ© / 6.3. PrĆ©dication et cure des Ć¢mes - VII. StƤnde, classes et religion : 7.1. La religiositĆ© de la paysannerie / 7.2. Ancrage urbain de la religiositĆ© chrĆ©tienne ancienne / 7.3. Noblesse et religiositĆ©. Le chevalier soldat de la foi / 7.4. Bureaucratie et religiositĆ© / 7.5. MultiplicitĆ© des formes de religiositĆ© Ā« bourgeoises Ā» / 7.6. Rationalisme Ć©conomique et rationalisme de lā€™Ć©thique religieuse / 7.7. Attitude religieuse atypique de la petite bourgeoisie ; religiositĆ© des artisans / 7.8. La religiositĆ© Ć©thique de la dĆ©livrance des couches les plus nĆ©gativement privilĆ©giĆ©es / 7.9. La religiositĆ© de la dĆ©livrance : dĆ©terminations de classe et dĆ©terminations de Stand / 7.10. ReligiositĆ© des parias juifs et hindous. Ressentiment / 7.11. La marque des couches intellectuelles dans les religions / 7.12. Lā€™intellectualisme petit-bourgeois dans le judaĆÆsme et le christianisme ancien / 7.13. Intellectualisme distinguĆ© et intellectualisme plĆ©bĆ©ien, intellectualisme paria et religiositĆ© de secte / 7.14. La constitution de communautĆ©s Ā« Ć©clairĆ©es Ā» dā€™un point de vue religieux en Europe occidentale - VIII. Le problĆØme de la thĆ©odicĆ©e : 8.1. Lā€™idĆ©e de Dieu du monothĆ©isme et lā€™imperfection du monde / 8.2. Types purs de la thĆ©odicĆ©e : lā€™eschatologie messianique / 8.3. Croyance dans lā€™au-delĆ , croyance dans la Providence, croyance dans la rĆ©tribution, croyance dans la prĆ©destination / 8.4. Les diffĆ©rentes tentatives de rĆ©solution du problĆØme de lā€™imperfection du monde - IX. DĆ©livrance et renaissance - X. Les voies de la dĆ©livrance et leur influence sur la conduite de vie : 10.1. ReligiositĆ© magique et ritualisme : les consĆ©quences de la religiositĆ© ritualiste de la piĆ©tĆ© / 10.2. La systĆ©matisation religieuse de lā€™Ć©thique du quotidien / 10.3. Extase, orgie, euphorie et mĆ©thode rationnelle de salut religieux / 10.4. SystĆ©matisation et rationalisation de la mĆ©thode de salut et de la conduite de vie /10.5. La virtuositĆ© religieuse / 10.6. AscĆØse du refus du monde et ascĆØse intramondaine / 10.7. Contemplation qui fuit le monde, contemplation mystique / 10.8. DiffĆ©rences entre les mystiques asiatique et occidentale / 10.9. Mythes du sauveur et sotĆ©riologies / 10.10. La dĆ©livrance par la grĆ¢ce sacramentelle et la grĆ¢ce dā€™institution / 10.11. La dĆ©livrance par la foi / 10.12. La dĆ©livrance par la grĆ¢ce de la prĆ©destination - XI. Lā€™Ć©thique religieuse et le Ā« monde Ā» : 11.1. La tension entre lā€™Ć©thique religieuse de la disposition dā€™esprit et le monde / 11.2. Lā€™Ć©thique de voisinage comme fondement de lā€™Ć©thique religieuse / 11.3. Le rejet religieux de lā€™usure / 11.4. La tension entre la rationalisation de la vie par lā€™Ć©thique religieuse et la rationalisation de la vie par lā€™Ć©conomie / 11.5. Lā€™acosmisme de lā€™amour religieux et la violence politique / 11.6. Positions variables du christianisme Ć lā€™Ć©gard de lā€™Etat / 11.7. Lā€™Ć©thique Ā« organique Ā» du mĆ©tier / 11.8. ReligiositĆ© et sexualitĆ© / 11.9. Lā€™Ć©thique de la fraternitĆ© et lā€™art - XII. Les religions civilisĆ©es et le Ā« monde Ā» : 12.1. Le judaĆÆsme et son caractĆØre tournĆ© vers le monde / 12.2. Attitude des catholiques, des juifs et des puritains Ć lā€™Ć©gard de la vie des affaires / 12.3. ReligiositĆ© de la Loi et traditionalisme dans le judaĆÆsme / 12.4. Juifs et puritains / 12.5. Lā€™islam et son caractĆØre adaptĆ© au monde / 12.6. Le bouddhisme ancien et son caractĆØre de fuite du monde / 12.7. Les religions civilisĆ©es et le capitalisme / 12.8. Le christianisme ancien et son refus du monde - Bibliographie - Index |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | DisponibilitƩ |
|---|---|---|---|---|---|
| TB/A 008 | TB/A 008 | Livre | Compactus | Livres empruntables | PrĆŖt possible Disponible |